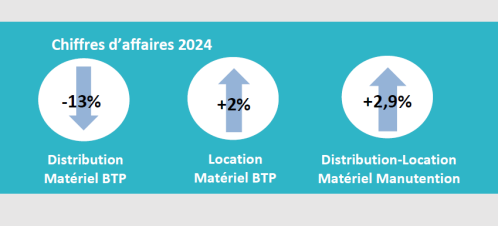DR
DR OLIVIER PETER
Comment qualifieriez-vous le contexte dans lequel vos adhérents évoluent ? Pas facile. Cela pour deux raisons. La première, c’est que la plupart des entreprises de fondations spéciales en France connaissent un creux d’activité qui était anticipé. La première phase des travaux du Grand Paris Express étant terminée, il était prévu une baisse d’act...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous