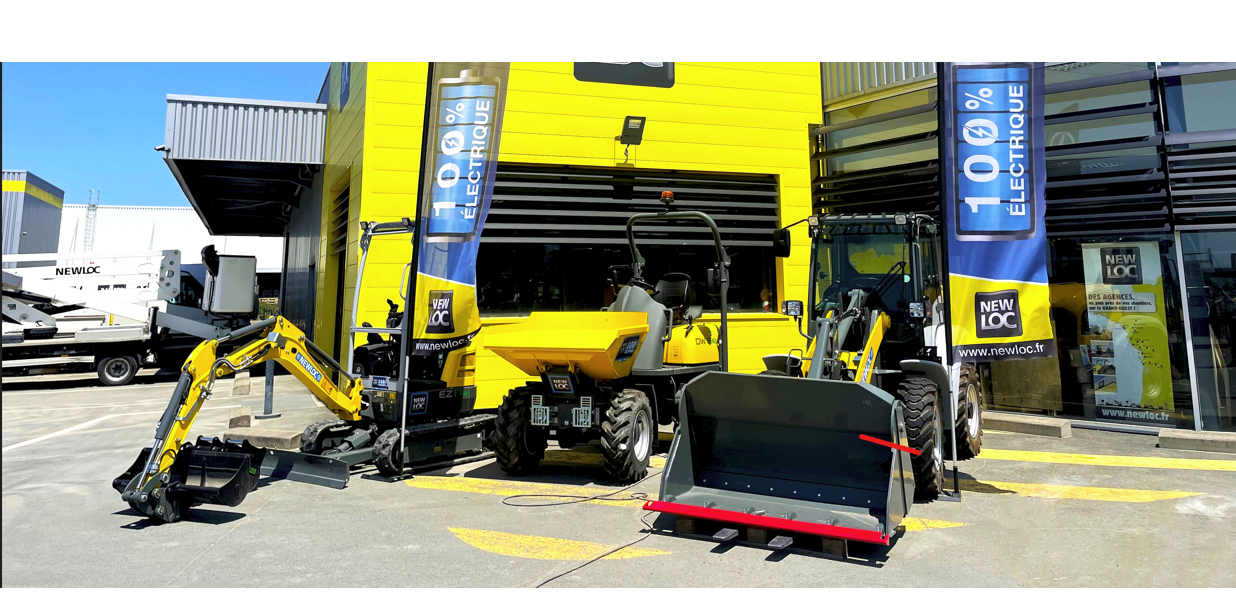L’association professionnelle de la location et de la distribution d’équipements de construction a tenu son congrès à Nantes, fin mars. L’occasion d’évoquer ses évolutions et de fournir quelques éléments de réflexions quant à l’avenir de la filière.
Congrès DLR : rassembler aujourd'hui pour peser demainAprès deux ans d’absence, le congrès DLR* était de retour. L’un des principales événements du secteur des matériels de chantier s’est tenu à Nantes le 31 mars et le 1er avril. La Fédération avait choisi de construire sa série de conférence autour du thème « hier, aujourd’hui, demainÂ...
Cet article est réservé aux
abonnés
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous